Être rappelé
Démonstration
Pour traiter votre demande, nous devons traiter vos données personnelles. Plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles ici.
Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) constituent un élément essentiel du cadre juridique des sites internet, applications et plateformes numériques.
Elles fixent les règles de fonctionnement du service et encadrent la relation entre l’éditeur et les utilisateurs.
À l’heure où la conformité au RGPD et la transparence numérique sont devenues incontournables, bien rédiger ses CGU n’est plus une simple formalité : c’est un gage de crédibilité, de confiance et de protection juridique.
Mais concrètement, à quoi servent les CGU ?
Sont-elles obligatoires pour tous les sites ?
Et comment les rédiger efficacement pour rester conforme aux obligations légales ?
Dans cet article, découvrez qu’est-ce que les Conditions Générales d’Utilisation (cgu définition), son rôle juridique, et les bonnes pratiques pour créer des conditions d’utilisation claires, complètes et conformes.
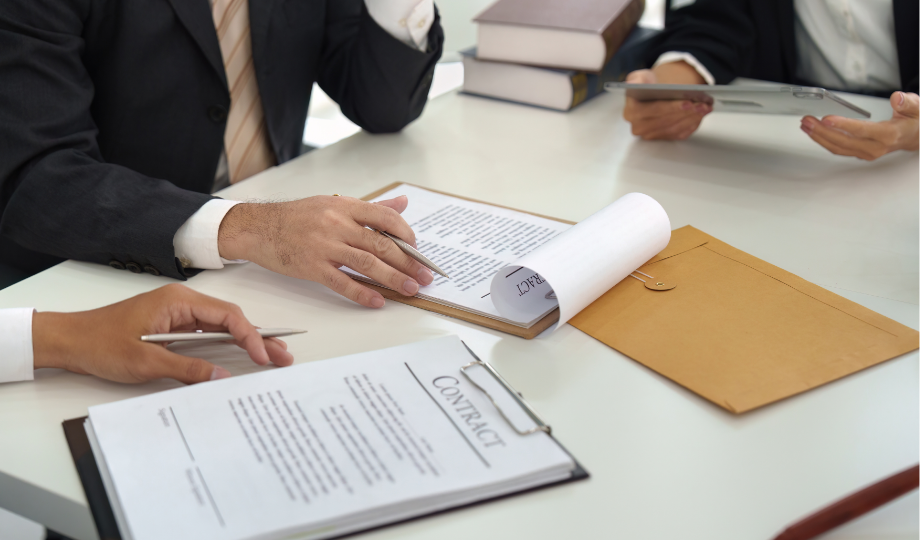
Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) constituent un document contractuel qui a vocation à encadrer l’accès et l’usage d’un service numérique (site internet, application ou plateforme en ligne). Elles s’appliquent à tous les sites et applications proposant des services en ligne.
Elles précisent les règles du jeu entre l’éditeur du service (l’entreprise) et les utilisateurs : droits, obligations en matière de comportement, responsabilités et limites d’usage.
Concrètement, les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour rôle :
Le RGPD impose une rédaction des CGU en langage simple et transparent, afin que chaque utilisateur puisse comprendre facilement les règles d’utilisation du site et les traitements de ses données.
Les CGU encadrent la relation non commerciale entre le site et ses utilisateurs — par opposition aux CGV, qui régissent la relation d’achat.
Oui, les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) peuvent avoir une valeur juridique, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Leur portée dépend du mode de présentation et d’acceptation par l’utilisateur. Elles peuvent donc être de simples mentions informatives ou avoir une véritable force contractuelle.
Lorsque les CGU sont présentées sans acceptation formelle, elles n’ont aucune valeur contractuelle.
Elles servent simplement à informer l’internaute sur le fonctionnement du site, les règles de navigation ou encore les bonnes pratiques à adopter. Dans ce cas, vous ne pouvez pas imposer de sanctions ni faire valoir vos droits sur leur seule base, car l’utilisateur ne s’y est pas juridiquement engagé.
L’objectif est alors de garantir la transparence : les CGU doivent être visibles et facilement accessibles, par exemple via un lien en pied de page ou dans le menu principal du site.
À l’inverse, les CGU deviennent opposables et juridiquement valables dès lors que l’utilisateur les accepte explicitement.
Cette acceptation transforme le texte en un véritable contrat entre l’éditeur du site et l’utilisateur.
Pour que cette valeur juridique soit reconnue, il faut pouvoir prouver que l’utilisateur a :
En l’absence de cette acceptation claire et vérifiable, les CGU ne peuvent pas être considérées comme un contrat.
Mais lorsque ces conditions sont réunies, elles ont pleine valeur juridique : elles protègent l’éditeur, définissent les responsabilités et encadrent les sanctions possibles en cas de manquement de l’utilisateur.
Comment faire accepter les CGU ?
Non, les CGU ne sont pas obligatoires, mais elles sont fortement recommandées dès qu’un site ou une plateforme :
Il convient de porter une attention particulière à la rédaction des conditions, car elles constituent le socle juridique de la relation avec les utilisateurs. La majorité des sites professionnels, même non contraints légalement, choisissent de les mettre en place pour sécuriser leur activité et démontrer leur sérieux dans l’économie numérique.
Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) concernent tous les acteurs d’un service en ligne :
Autrement dit, les CGU s’appliquent à tout site internet, application ou plateforme permettant un accès ou une interaction en ligne — qu’il s’agisse d’un site vitrine, d’un e-commerce, d’une marketplace, d’un forum ou d’un outil SaaS.
Elles servent à définir les règles du jeu entre l’éditeur et les utilisateurs, à prévenir les abus et à encadrer l’utilisation du service de manière claire et transparente.
| Document | Objectif principal | Contenu essentiel | Caractère obligatoire | Public concerné |
|---|---|---|---|---|
| CGU (Conditions Générales d’Utilisation) | Encadrer l’utilisation d’un site ou d’une application | Règles d’utilisation, responsabilités, droits et obligations, sanctions, fonctionnement du service | ❌ Non obligatoire pour tous les sites, mais fortement recommandée | Tous les utilisateurs du site ou de l’application |
| CGV (Conditions Générales de Vente) | Encadrer la relation commerciale entre vendeur et acheteur | Prix, paiement, livraison, droit de rétractation, garanties, service après-vente | ✅ Obligatoire pour les ventes B2C et recommandée en B2B | Clients ou acheteurs |
| Mentions légales | Identifier l’éditeur et l’hébergeur du site | Nom, raison sociale, adresse, contact, SIRET, hébergeur, directeur de publication | ✅ Obligatoire pour tous les sites (professionnels et particuliers) | Tout internaute consultant le site |
| Politique de confidentialité | Informer sur la collecte et le traitement des données personnelles | Données collectées, finalités, base légale, durée de conservation, droits RGPD, contact DPO | ✅ Obligatoire dès qu’il y a collecte de données personnelles | Utilisateurs ou visiteurs dont les données sont traitées |
Concrètement ce qu’il faut retenir :

Cette première section définit la finalité des CGU et le périmètre du service qu’elles couvrent. Elle précise à quoi s’applique le document : site web, application mobile, plateforme, espace client, forum, etc. Elle peut également indiquer les services ou fonctionnalités exclus du périmètre.
Exemple :
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités d’accès et d’utilisation du site [nomdusite.com] par tout utilisateur, ainsi que les droits et obligations de l’éditeur et des utilisateurs.
C’est une clause d’introduction essentielle : elle permet de situer le contrat et d’éviter toute ambiguïté sur son domaine d’application.
Cette rubrique encadre la manière dont un utilisateur peut accéder au service. Elle décrit les conditions techniques nécessaires (connexion Internet, matériel compatible, navigateur requis) et les éventuelles restrictions (âge minimum, inscription obligatoire, localisation géographique).
Elle peut aussi préciser les modalités d’ouverture et de fermeture d’un compte, les identifiants, et les responsabilités liées à la confidentialité du mot de passe. Dans certains cas, il est utile d’y mentionner les limitations d’accès : maintenance, pannes, mises à jour, ou suspension temporaire du service. Cette étape est cruciale pour clarifier les prérequis techniques.
Exemple :
L’accès au service est ouvert à toute personne disposant d’une connexion Internet et d’un équipement compatible. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre temporairement l’accès pour des opérations de maintenance.
Cette partie précise ce que les utilisateurs ont le droit ou non de faire sur la plateforme. Elle vise à prévenir les comportements abusifs, illicites ou contraires aux valeurs du service. L’administrateur du site conserve le droit de contrôle sur l’ensemble des activités.
On y énonce par exemple :
Cette section peut aussi prévoir la modération des contenus et les sanctions en cas de manquement (suppression de contenu, suspension de compte, exclusion). C’est un outil clé de gouvernance numérique, surtout pour les forums, réseaux sociaux et plateformes participatives.
Cette clause protège les droits d’auteur et les éléments visuels ou textuels du site. Elle indique que les textes, images, logos, graphismes, marques ou bases de données appartiennent à l’éditeur ou à des tiers autorisés, et qu’ils sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle.
L’utilisateur est informé qu’il ne peut procéder à la reproduction, copie, distribution ou exploitation des contenus sans autorisation écrite. Cette rubrique peut aussi préciser les conditions de réutilisation des contenus (licence, citation, partage sous conditions).
Dans le cas d’un service collaboratif (ex. plateforme de publication), il est essentiel de prévoir la clause de cession de droits : elle encadre les contenus créés par les utilisateurs et le droit du site de les héberger ou de les diffuser.
Les CGU doivent inclure un volet informant l’utilisateur du traitement de ses données personnelles. Il ne s’agit pas de reproduire la politique de confidentialité, mais de rappeler brièvement :
Cette clause doit être cohérente avec le RGPD. Elle démontre que le site agit en transparence et respecte la réglementation sur la protection des données. Un support documentaire clair facilite la consultation par les utilisateurs.
C’est l’une des clauses les plus importantes. Elle définit les obligations de l’éditeur et les limites de sa responsabilité en cas de dysfonctionnement, d’erreur, ou de dommage.
L’éditeur peut indiquer qu’il s’efforce d’assurer un service fiable, mais qu’il ne garantit pas une disponibilité permanente ni l’absence d’erreurs. Il peut aussi préciser qu’il ne peut être tenu responsable des conséquences liées à un usage frauduleux du service ou à des événements externes (cyberattaques, pannes, cas de force majeure).
Exemple :
L’éditeur ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du service, notamment en cas de perte de données ou d’interruption de connexion.
Cette clause doit cependant rester équilibrée : elle ne peut pas exonérer totalement l’éditeur de toute responsabilité. Elle participe au bon fonctionnement du service en clarifiant les limites juridiques.
Cette section indique combien de temps les CGU restent applicables et dans quelles conditions un compte peut être résilié, suspendu ou supprimé.
Elle prévoit :
Cette partie renforce la sécurité juridique et protège la liberté de chaque partie de mettre fin à la relation.
Les CGU ne sont pas figées : elles doivent pouvoir évoluer. Cette rubrique encadre le processus de mise à jour du document et précise comment l’utilisateur sera informé.
L’éditeur doit mentionner :
L’objectif est d’assurer la transparence et d’éviter toute contestation en cas de changement.
Cette clause détermine la loi qui s’applique au contrat et le tribunal compétent en cas de litige. Pour un site basé en France, on indique généralement :
Les présentes CGU sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou exécution sera de la compétence exclusive des tribunaux français.
Si le service s’adresse à des utilisateurs étrangers, il peut être utile de préciser les cas particuliers (ex. : recours à la médiation ou au règlement en ligne des litiges de la Commission européenne). La mention du lieu de juridiction compétente évite les incertitudes juridiques et simplifie la résolution des conflits.

Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) doivent être facilement accessibles à tout moment pour les utilisateurs d’un site internet ou d’un plateforme.
Voici les principaux emplacements recommandés :
La rédaction des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) doit être réalisée avec une grande précision, car il s’agit d’un document juridique à valeur contractuelle. En principe, elles sont rédigées par un avocat spécialisé en droit du numérique, un juriste d’entreprise, ou un prestataire juriste expert en conformité.
Chez Dipeeo, notre équipe de juristes experts rédige des CGU sur mesure pour chaque entreprise. Grâce à notre plateforme SaaS et à notre expertise en conformité RGPD, nous produisons des documents complets, clairs et juridiquement solides, parfaitement adaptés à l’activité et aux spécificités de chaque site ou application. Découvrez notre offre.
La réponse dépend du public visé par votre site ou votre application.
En France, la loi Toubon impose que les CGU soient rédigées en français dès lors que le service s’adresse à un public francophone.
Cette exigence garantit la compréhension des utilisateurs et la valeur juridique du document sur le territoire français.
En revanche, si votre service est accessible depuis l’étranger ou destiné à un public international, il est fortement recommandé de proposer plusieurs versions linguistiques cohérentes.
Chaque version doit être fidèle au texte original et respecter la même structure pour éviter toute ambiguïté juridique.
Au-delà de la traduction, il est essentiel d’adapter les CGU au droit local : les réglementations en vigueur varient d’un pays à l’autre (protection des consommateurs, données personnelles, responsabilité, etc.).
Mentionnez toujours le droit applicable et la juridiction compétente — par exemple : droit français, tribunaux de Paris.
Cette approche permet de garantir la conformité juridique de votre site, de prévenir les litiges transfrontaliers et d’inspirer confiance aux utilisateurs, quel que soit leur pays d’origine.
Pas toujours, mais oui, en cas de modification importante.
Lorsqu’une entreprise met à jour ses Conditions Générales d’Utilisation (CGU), elle n’a pas besoin de prévenir les utilisateurs pour de simples ajustements mineurs (corrections de forme, précisions rédactionnelles, mise à jour d’un lien, etc.).
En revanche, toute modification significative doit être communiquée clairement. C’est le cas lorsque les nouvelles CGU ont un impact direct sur les droits, les données personnelles ou le fonctionnement du service :
Dans ces situations, le RGPD et le droit de la consommation exigent une information claire, visible et préalable des utilisateurs. Vous devez les prévenir avant l’entrée en vigueur des nouvelles CGU, et dans certains cas, recueillir à nouveau leur consentement.
Un exemple récent illustre parfaitement l’importance de cette transparence : WeTransfer, en juillet 2025, a discrètement modifié ses CGU pour y inclure une mention selon laquelle certains fichiers transférés pouvaient être utilisés « pour améliorer ses services via l’intelligence artificielle ». Problème : cette information était insuffisamment visible et les modalités d’utilisation restaient floues. Résultat : une enquête ouverte par l’autorité néerlandaise de protection des données, un recul de confiance chez les utilisateurs et une perte de crédibilité pour la marque.
Les CGU constituent un cadre de confiance entre le site et ses utilisateurs. Bien rédigées, elles :
Un document clair, daté et accessible permet d’éviter les litiges et de renforcer la crédibilité du service.
Découvrez notre service de rédaction sur mesure de CGU.